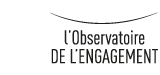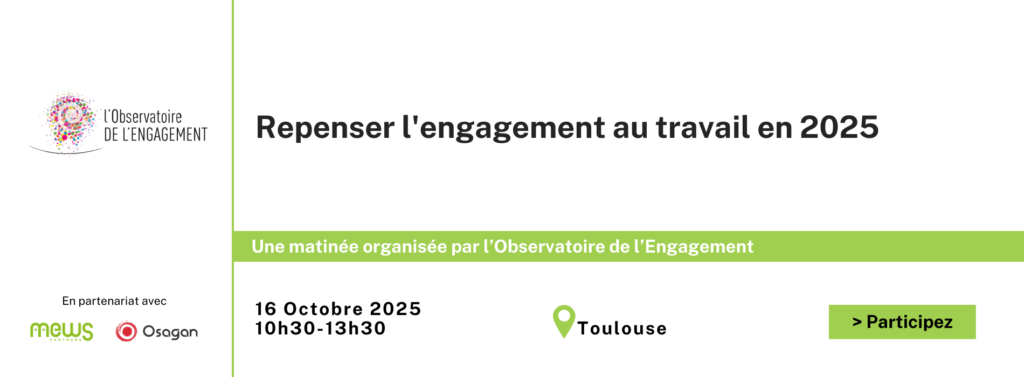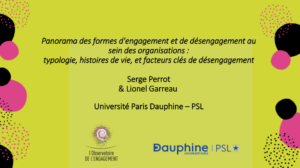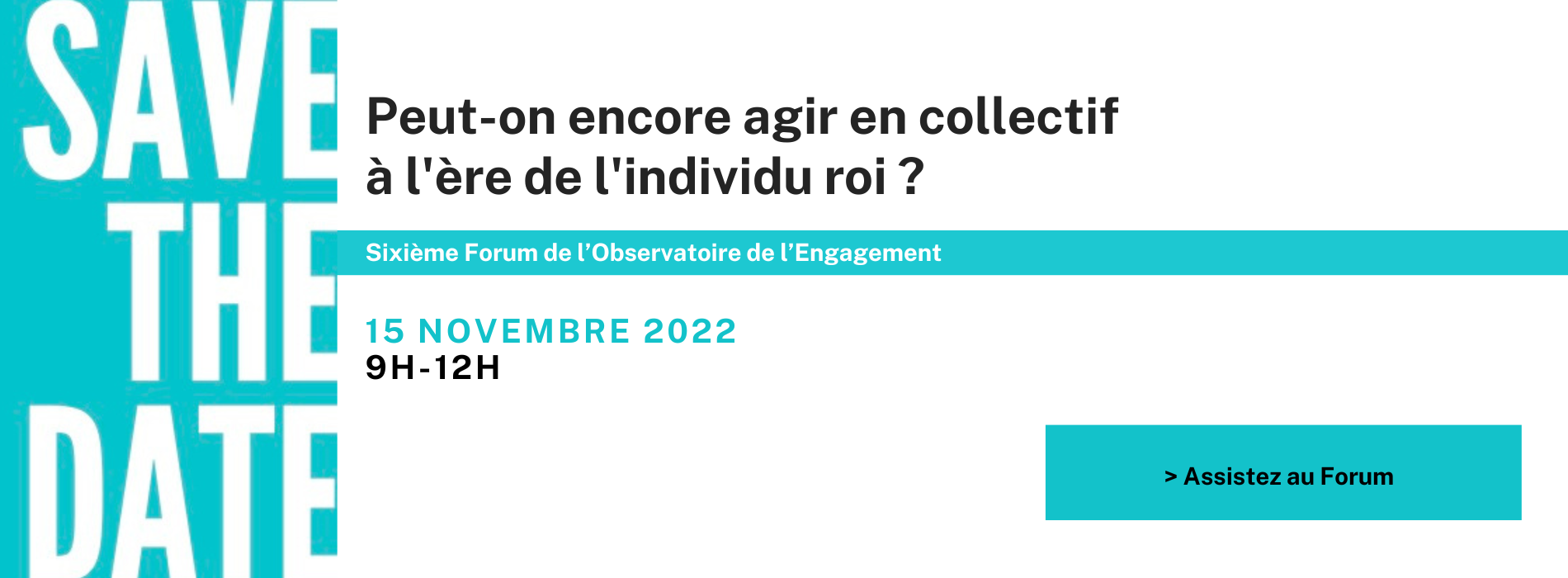Matinée de l’Observatoire à Toulouse – Les temps forts en images
Le jeudi 16 octobre 2025, près de 40 personnes ont participé à la matinée organisée par l’Observatoire, en partenariat avec Mews Partners & Osagan.
Présentation du Think Tank, restitution de la dernière étude, table-ronde, session de questions-réponses, atelier collaboratif… La rencontre a fait un tour d’horizon pour mieux comprendre les ressorts de l’engagement.
La matinée en images

Welcome et présentation de l’Observatoire par Fabienne Simon.
« Pour comprendre l’engagement, il faut s’intéresser aux 3 dimensions d’un même mouvement. Il y a d’abord une adhésion à un projet (avec la tête), une contribution à sa mise en œuvre (avec le corps) et une recommandation de l’entreprise (avec le cœur) »

Présentation de l’étude Panorama des formes d’engagement : focus sur ce qui désengage dans nos organisations

Questions – réponses

Thomas Bourlon et Sébastien Matty. Deux témoignages pour mieux appréhender l’engagement et poser un regard concret sur les leviers managériaux qui font la différence.

Un temps d’intelligence collective pour identifier les leviers et les freins d’engagement propres à un secteur.

Un atelier collaboratif sur les bonnes pratiques pour engager.

Un atelier collaboratif sur les bonnes pratiques pour engager.